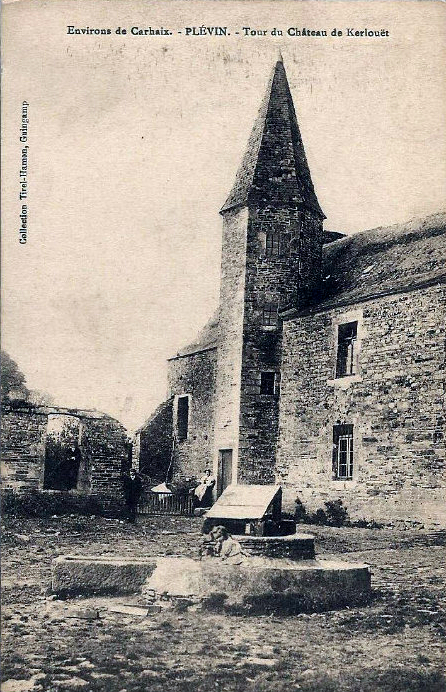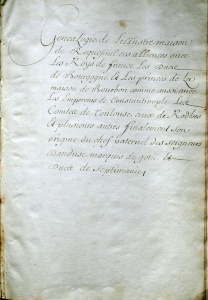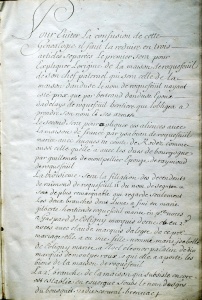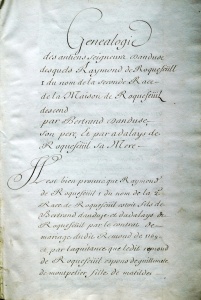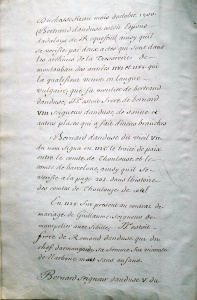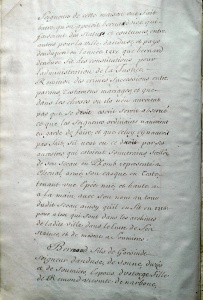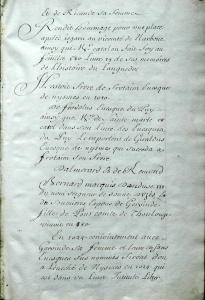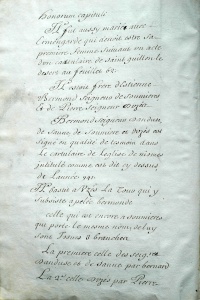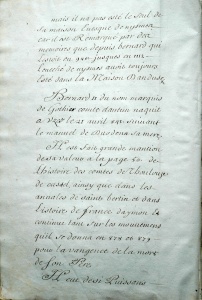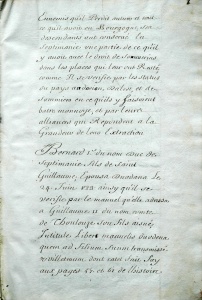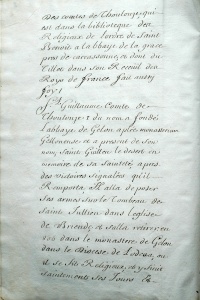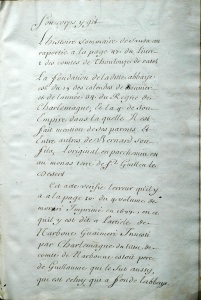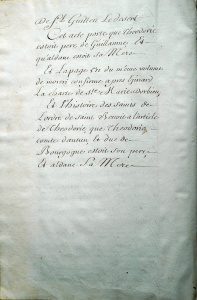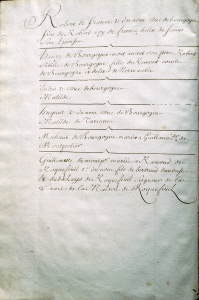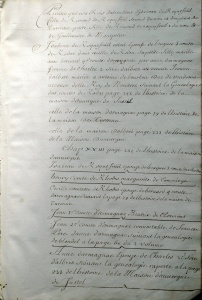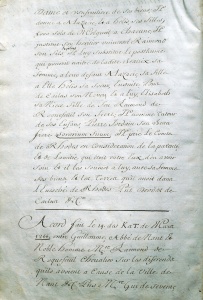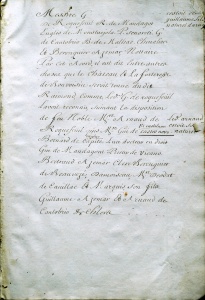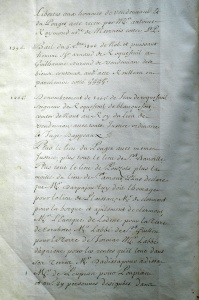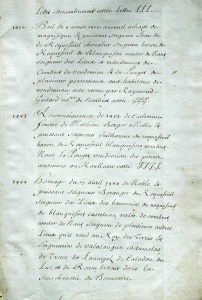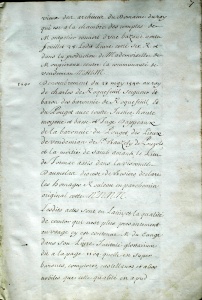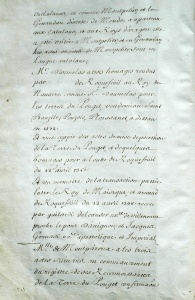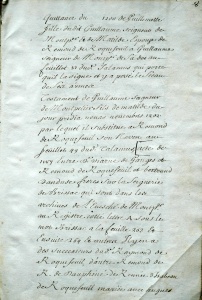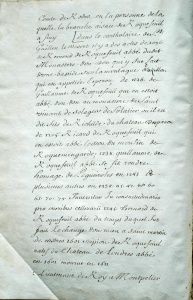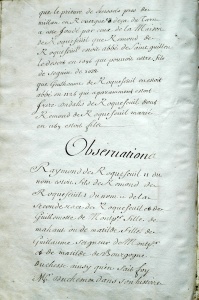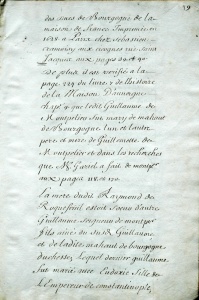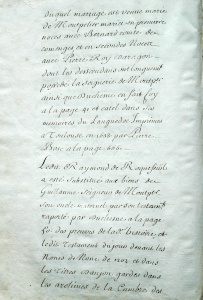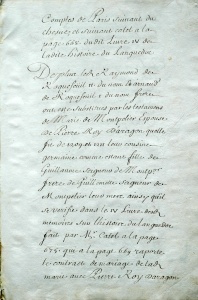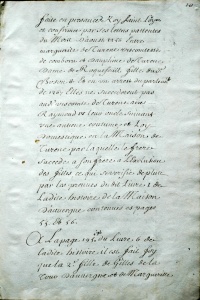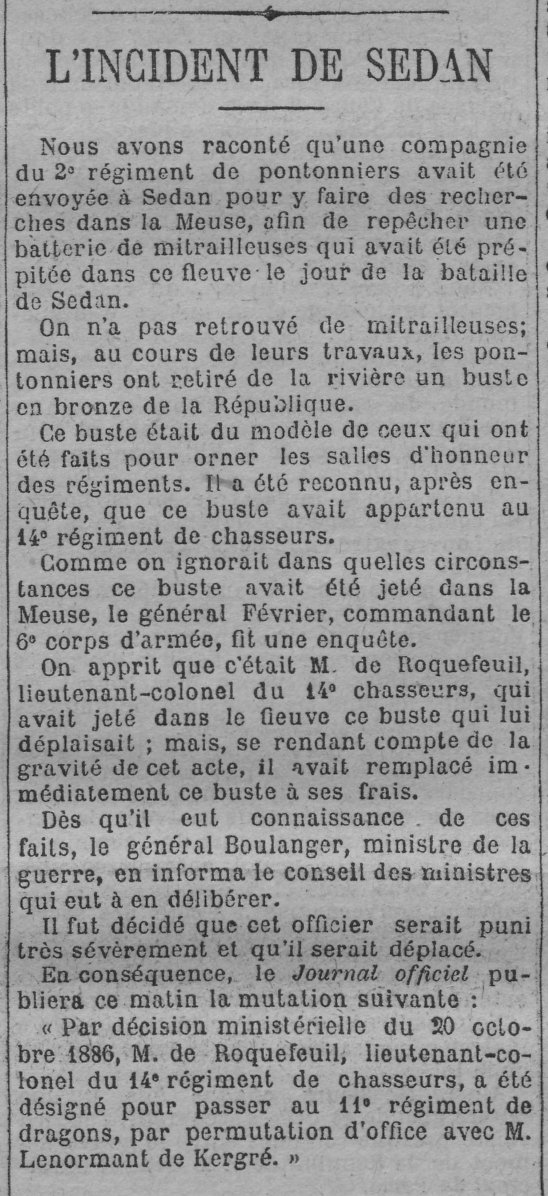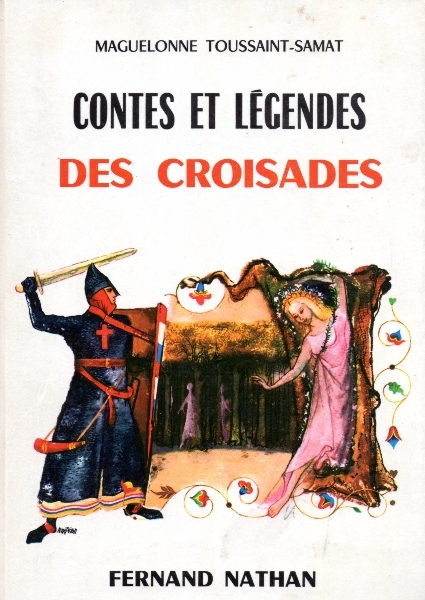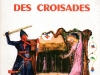|
Page 1:
Généalogie de l’illustre Maison de Roquefeuil, ses alliances avec les Roys de France, les ducs de Bourgogne et les princes de la Maison de Bourbon comme aussi avec les Empereurs de Constantinople, les comtes de Toulouse, ceux de Rodez et plusieurs autres. Finalement, son origine du chef paternel des seigneurs d’Anduze, marquis de Gothie et ducs de Septimanie.
Page 2:
Pour éviter la confusion de cette généalogie, il faut la réduire en trois articles séparés. Le premier sera pour expliquer l’origine de la Maison de Roquefeuil de son chef paternel qui sera celle de la Maison d’Anduze. Le nom de Roquefeuil n’ayant été pris que par Bertrand d’Anduze, époux d’Adélaïs de Roquefeuil, héritière qui l’obligea à prendre son nom et ses armes.
Le second sera pour expliquer ses alliances avec la Maison de France par Isabeau de Roquefeuil mariée avec Hugues III comte de Rodez, comme aussi celle qu’elle a avec les ducs de Bourgogne par Guillemette de Montpellier, épouse de Raymond de Roquefeuil.
La troisième sera la filiation des descendants de Raymond de Roquefeuil IIème du nom de ce qu’on en sait de plus remarquable qui regarde seulement les deux branches dont l’une a fini en Marie Gilberte, héritière de Roquefeuil, mariée en premières noces à Gaspard de Coligny, marquis d’Orne et en seconde noces avec Claude, marquis d’Alègre. De ce premier mariage elle a eu une fille nommée Marie-Isabelle de Coligny, mariée à Noël Eléonor Palatin de Dio, marquis de Montperroux à qui elle a apporté les biens de la Maison de Roquefeuil. La deuxième branche de la Maison qui subsiste encore est établie en Rouergue sous le nom des seigneurs du Bousquet, Padiès, Cocural, Brennac.
Page 3:
Généalogie
des anciens seigneurs d’Anduze desquels Raymond de Roquefeuil Ier du nom de la seconde race de la Maison de Roquefeuil descend par Bertrand d’Anduze son père et Adalaÿs de Roquefeuil sa mère.
Il est bien prouvé que Raymond de Roquefeuil Ier du nom de la deuxième race de Roquefeuil était fils de Bertrand d’Anduze et d’Adalaÿs de Roquefeuil par le contrat de mariage dudit Raymond de 1169 et par la quittance que ledit Raymond de Roquefeuil époux de Guillemette de Montpellier, fille de Mathilde (ndlr: de Bourgogne )
Page 4:
duchesse fit au mois d’octobre 1200.
Bertrand d’Anduze était époux d’Adalaÿs de Roquefeuil ainsi qu’il se vérifie par deux actes qui sont dans les archives de la Trésorerie de Montauban des années 1182 et 1184 qui la qualifie veuve en langue vulgaire que fit moulier de Bertrand d’Anduze. Il était frère de Bernard VIII d’Anduze, de Sonne et autres places qui a fait diverses branches.
Bernard d’Anduze, dit Vieil, VIIème du nom, signa en 1125 le traité de paix entre le comte de Toulouse et le comte de Barcelone ainsi qu’il se vérifie à la page 263 dans l’Histoire des comtes de Toulouse de Catel.
En 1129 fut présent au contrat de mariage de Guillaume seigneur de Montpellier avec Sibille. Il était frère de Remond d’Anduze qui du chef d’Armangarde sa femme fut vicomte de Narbonne mort sans enfants.
Bernard, seigneur d’Anduze, Vème du
Page 5:
nom était frère utérin de Guillaume seigneur de Montpellier fils d’Hermangarde ainsi qu’il se vérifie par le testament de (…??…illisible: NDLR) par lequel il lui fait un don et a ses enfants qui est au feuillet 91 du Ier tome des seigneurs de Montpellier ci-devant cité et au feuillet 243 du registre coté lettre D des archives de l’évêché de Montpellier.
Il était frère de Bertrand d’Anduze ainsi qu’il en a fait foi au feuillet 2eme (…??…illisible: NDLR) cartulaire de Saint Guilhem le Désert.
Raymond seigneur d’Anduze, fils d’Adalaÿs de Mandagot époux d’Ermengarde donna en 1077, conjointement avec Bernard son père, marquis, et Adalaÿs sa mère ce qu’ils avaient dépendant du chateau de Meirueis à l’abbaye de Selan dont l’acte est au feuillet 62. 2ème d’un cartulaire de Saint Guilhem le Désert.
Bernard IVème du nom fils d’Eustorga époux d’Adalaÿs de Mandagot, marquis, chef de la branche d’Anduze dans laquelle le nom de Bernard a été comme héréditaire en mémoire de Bernard, duc de Septimanie et de Bernard, marquis de Gothie, desquels ils sont issus, nom qui fut donné même à la monnaie que les
Page 6:
seigneurs de cette Maison ont fait battre qu’on appelait « Bernardoise », qui faisaient des statuts et coutumes entre autres pour la ville d’Anduze et pays Anduzien en l’année 1217, que Bernard fit des constitutions pour l’administration de la Justice, rémissions des crimes, successions entre parents, testaments, mariages et que dans les choses où ils n’en auraient pas que ce droit écrit serait observé, ce que les seigneurs ordinaires n’auraient eu garde de faire, et ce que celui-ci n’aurait pas fait s’il n’eut eu ce droit par ses ancêtres qui étaient souverains, scellées de son sceau en plomb représenté à cheval, armé, son casque en tête, tenant une épée nue et haute à la main avec son nom autour dudit sceau, ainsi qu’il en fit en 1216 pour Alès qui sont dans les archives de ladite Ville, dans le livre de ses statuts, et de même à Sommières.
Bernard, fils de Garsinde, seigneur d’Anduze, de Sauve, d’Uzès et de Sommières, époux d’Eustorge, fille de Raymond vicomte de Narbonne.
Page 7:
et de Ricarde sa femme.
Rendit hommage pour une place appelée Isguarn au vicomté de Narbonne ainsi que Mr. Catalan fait foi aux feuillet 580, liure 14 de ses mémoires de l’Histoire du Languedoc.
Il était frère de Frotaim, évêque de Nîmes en 1010.
De Frodolus, évêque du Puy ainsi que de Mrs de Sainte Marte et Catel dans son livre des évêques du Puy le rapportent de Géraldus, évêque de Nîmes qui succéda à Frotaim son frêre.
D’Almerade et de Remond.
Bernard, marquis d’Anduze IIIème du nom, seigneur de Sauve, d’Uzès et de Sommières, époux de Gersinde, fils de Pons, comte de Toulouse vivait en 980.
En 1024, conjointement avec Gersinde, sa femme, et leurs enfants, évêques susnommés, firent don à l’évêché de Nîmes en 1024 qui est dans un livre intitulé Liber
Page 8:
honorum capituli.
Il fut aussi marié avec Ermengarde qui devait être sa première femme suivant un acte d’un cartulaire de Saint Guilhem le Désert au feuillet 62.
Il était frère d’Estienne Bermond seigneur de Sommières et de Pierre, seigneur d’Uzès.
Bermond, seigneur d’Anduze, de Sauve, de Sommières et d’Uzès est signé en qualité de témoin dans le cartulaire de l’église de Nîmes intitulé comme est dit ci-dessus de l’année 941.
Il bâtit à Uzès la tour qui y subsiste, appelée « Bermonde ». Celle qui est encore à Sommières qui porte le même nom. De lui sont issues trois branches.
La première est celle des seigneurs d’Anduze et de Sauve par Bernard.
La 2ème, celle d’Uzès par Pierre
Page 9:
La 3ème, celle des seigneurs de Sommières par Etienne Bermond.
Pierre, seigneur d’Anduze, de Sauve, d’Uzès et de Sommières vivait en 980.
Il en est fait mention dans la donation du château de Saint Martial faite par Bernard, évêque de Nîmes, qui y est dénommé « frater Petri Anduciamancis Domini » du 25 février de l’année VII de Louis Doutremur l’an 943 qui est dans ledit cartulaire « Liber Honorum Capituli ».
Il est fait mention de ce bernard, évêque de Nîmes à la page 980 du livre des mémoires de l’histoire du Languedoc de Catel et dans celle des évêques de France de Sainte Marthe.
Il y a méprise dans la date de la donation en ce que Bernard qui la fit était mort en 956
Page 10:
Mais il n’a pas été le seul de sa maison évêque de Nîmes car il est remarqué par des mémoires que depuis Bernard qui l’était en 940 jusques en 1112, l’évêché de Nîmes avait toujours été dans la maison d’Anduze.
Bernard IIème du nom, marquis de Gothie, comte d’Autun, naquit à Uzès le 21 avril 841 selon le manuel de Duodena sa mère.
Il est fait grande mention de sa valeur à la page 56 de l’Histoire des comtes de Toulouse de Castel ainsi que dans les annales de Saint Bertin et dans l’Histoire de France d’Aymon et continue tant sur les mouvements qu’il se donna en 878 et 879 pour la vengeance de la mort de son père.
Il eu de si puissants
Page 11:
ennemis qu’il perdit Autun et tout ce qu’il avait en Bourgogne. Ses descendants ont conservé en Septimanie de ce qu’il y avait avec le droit de souverain dans les places qui leur ont resté, comme il se vérifie par les statuts du pays Anduzien, d’Alès et de Sommières en ce qu’ils y faisaient battre monnaie et, par leurs alliances qui répondent à la grandeur de leur extraction.
Bernard Ier du nom, duc de Septimanie, fils de Saint Guillaume épousa Duodana le 24 juin 823 ainsi qu’il se vérifie par le manuel qu’elle adressa à Guillaume IIème du nom, comte de Toulouse, son fils aîné, intitulé « Liber manuelis Duidena quem ad filium suum transmisse vovilletnum » dont Catel fait foi aux pages 57 et 61 de l’Histoire
Page 12:
des comtes de Toulouse qui est dans la bibliothèque des religieux de l’ordre de Saint Benoît à l’abbaye de la Grâce près de Carcassonne et dont du Tillet dans son recueil des Roys de France fait aussi foy.
Saint Guillaume, comte de Toulouse, Ier du nom a fondé l’abbaye de Gellone appelée monasterium Gellonense et à présent de son nom Saint Guilhem le désert en mémoire de sa sainteté après des victoires signalées qu’il remporta. Il alla déposer ses armes sur le tombeau de Saint Julien dans l’église de Brioude et s’alla retirer en 806 dans le monastère de Gellone dans dans le diocèse de Lodève où il se fit religieux et y finit saintement ses jours et
Page 13:
son corps y gît.
L’histoire sommaire de Sausa (?) est rapportée à la page 47 du livre I des comtes de Toulouse de Catel.
La fondation de ladite abbaye est du 19 des calendes (de janvier ?) et de l’année 34 du règne de Charlemagne et la 4ème de son empire dans laquelle il est fait mention de ses parents et, entre autres de Bernard son fils. L’original en parchemin est au monastère de Saint Guilhem le Désert.
Cet acte vérifie l’erreur qui est à la page 10 du 4ème volume de Moreri, imprimé en 1699, en ce qu’il y est dit à l’article de Narbonne (Guaimeri ?) investi par Charlemagne du titre de comte de Narbonne, était père de Guillaume, qui le fut aussi, qui est celui qui a fondé l’abbaye
Page 14:
de Saint Guilhem le Désert.
Cet acte porte que Théodoric était père de guillaume et qu’Aldane était sa mère.
Et la page 571 du même volume de Moreri confirme après Ezinard la charte de Sainte Marie Dorbieu.
Et l’Histoire des saints de l’ordre de Saint Benoît à l’article de Théodoric que Théodoric, comte d’Autun et duc de Bourgogne était son père et Aldane sa mère.
Page 15:
Preuve que la seconde race de la Maison de Roquefeuil descend par Mahaut de Bourgogne, mère de Guillemette de Montpellier épouse de Raymond de Roquefeuil Ier du nom, de Robert de France duc de Bourgogne fils puiné de Robert, roi de France qui l’était du roi Hugues Capet
suivant la généalogie rapportée dans l’Histoire de la Maison d’Auvergne de Justel à la page 224.
Dans celle de la Maison de France par Sainte Marthe de la 3ème édition.
Dans celle des deux de Bourgogne de Duchesne.
Dans celle de David Blondel intitulé « Genealogia Franceia », de Moreri.
Par ou se vérifie l’erreur que Marie de Montpellier épouse Pierre roi d’Arago fut fille de la duchesse Mathilde, fille d’Emmanuel empereur de Constantinople suivant ce qui est contenu dans le 4ème livre des mémoires de l’Histoire du Languedoc de Catel ou ou il est dit à la page 663 et 668 que le fils de Guillaume de Montpellier fils de Sibille fur marié avec la duchesse Mathilde, fille de Manuel Empereur de Constatinople car il est certain que cette Mathilde duchesse était fille de Hugues II duc de Bourgogne, de la Maison Royale de France, ainsi qu’il se prouve encore par la quittance que tant Raymond de Roquefeuil que Guillemette de Montpellier son épouse firent à Guillaume seigneur de Montpellier, IVème du nom, fils de Mathilde duchesse au mois d’octobre 1200 au feuillet 81 du registre de l’Hôtel de Ville de Montpellier.
Chapitre IX page 224 de l’Histoire de la Maison d’Auvergne:
Page 16:
Robert de France, Ier du nom, duc de Bourgogne,
fils de Robert, roy de France. Helix de Semur son épouse.
↓
Henry de Bourgogne, mort avant son père Robert. Sibille de Bourgogne
fille de Remont comte de Bourgogne et d’Helix de Normandie.
↓
Eudes Ier Duc de Bourgogne. Mathilde.
↓
Hugues IIème du nom, duc de Bourgogne. Mathilde de Turenne.
↓
Mahaut de Bourgogne mariée à Guillaume, seigneur de Montpellier.
↓
Guillemette de Montpellier mariée à Raymond de Roquefeuil Ier du nom,
fils de Bertrand d’Anduze et d’Adalaÿs de Roquefeuil,
seigneur de la deuxième race de la Maison de Roquefeuil.
|